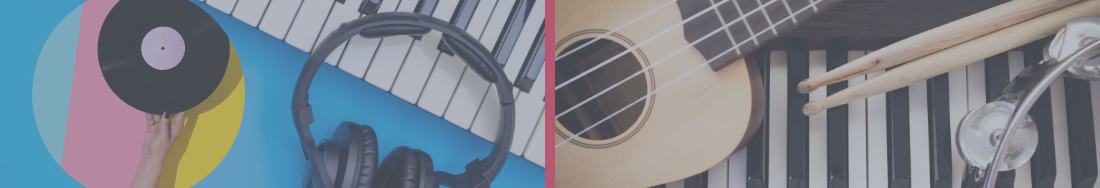Racha Arodaky, une pianiste socialement engagée
Son nouvel enregistrement des Partitas de Bach en poche, la pianiste Racha Arodaky part en tournée. De la salle Wagram aux murs des prisons, cette atypique en musique classique milite pour le décloisonnement de son art. Interview.
Si Racha Arodaky vous invite un jour dans son salon, par une matinée blanche et pluvieuse, elle s’assurera sans doute de vous mettre à l’aise et de vous réchauffer, en vous présentant toute une collection de thés parfumés. Faites mine de refuser, et elle sortira de ses placards de mignons biscuits qui achèveront de vous convaincre. De quoi bien entamer une conversation sur Bach, les banlieues et le masochisme des pianistes.
Vous avez l’habitude d’aller jouer en banlieue, en milieu carcéral… qu’est-ce qui vous pousse à aller à la rencontre d’un tel public?
Jusqu’à l’âge de 16 ans j’ai vécu dans des HLM qui étaient tout sauf excitants. Mes parents étaient des immigrés syriens arrivés en France alors que j’avais à peine deux ans, j’ai donc baigné dans la culture de ce pays et me sens complètement française. Nous avons vécu d’abord dans une cité à Antony, puis à Bagneux, avec pour seul décor des immeubles et du béton. Enfant, on ne peut pas dire que j’ai vécu dans le luxe. A l’école, j’ai souffert du racisme, d’insultes du genre « sale arabe »… Vivre tout cela vous fait voir les choses différemment. On n’aborde pas la banlieue de la même manière selon qu’on y a soi-même vécu, ou selon, comme certains de mes collègues, qu’on vient d’un milieu aisé pour y « faire du social ». On n’aborde pas non plus la prison de la même façon quand on connaît des personnes qui y ont été. J’ai côtoyé tous ces milieux, je ne m’y sens pas étrangère, d’où mon implication : je sais à quel point il n’y a presque rien là-bas.
Face aux enfants ou aux détenus, vous sentez-vous investie d’une mission?
Ma démarche artistique est inséparable d’un engagement social. Nous, artistes, devrions être les vecteurs d’une solidarité, d’une humanité, d’un partage situés en dehors des circuits marchands. La gratuité me paraît être une valeur fondamentale. Malheureusement, les pouvoirs publics nous aident de moins en moins, les subventions à la culture et à la musique ne cessent de se réduire, en contrepartie d’une privatisation croissante. L’argent qui l’irrigue vient à présent de banques, de grands groupes d’assurance, du mécénat privé. Je suis pourtant intimement convaincue que la culture est un moyen de changer les choses, d’unir les gens autour d’une même émotion.
Quelle est ma contribution ? Aller jouer dans les banlieues, dans les gymnases de cités sinistres, dans un cadre où vous ne pouvez pas vous empêcher de penser : « Dieu ce que c’est bon de partager ce moment avec des gens qui ne connaissent rien à la musique, qui vous connaissent à peine, ou du moins ne vous ont certainement pas entendu sur France Musique, ne vous hissent pas sur un piédestal, mais viennent simplement partager un moment d’émotion ! » La musique peut sauver de la violence d’un environnement social, de la misère, elle ouvre l’esprit !
Je me souviens d’un concert dans une ZEP : le regard des enfants à mon arrivée, et leur regard après m’avoir entendue n’était plus le même. Je lisais dans leurs yeux une dureté, une violence, celle de leur quotidien, de parents chômeurs, de privations, d’un appartement déglingué, de la rue, du collège… Ils sont crispés, énervés, et puis vous jouez… et ces enfants deviennent de vrais enfants ! Pendant deux heures, on leur accorde le droit d’être légers. Beaucoup m’ont ensuite demandée d’être leur amie sur Facebook !
Mais vous vous produisez aussi dans des salles plus conventionnelles comme à Wagram le 4 février dernier. Y a-t-il dans ce cas une attitude et des attentes différentes, de la part de votre public comme de la vôtre?
Mon public lui-même n’est pas conventionnel ! Après ce récital, quelqu’un m’a confié : « on aurait dit un concert rock ! » Il y avait une vraie énergie, les gens venaient se faire du bien, pas critiquer, ils étaient là parce qu’ils m’apprécient, que ce sont des aficionados de mes disques… mais pas forcément du classique ! Il y a évidemment des connaisseurs, mais pour une bonne part, et je l’ai vu lors des dédicaces, ce ne sont pas des habitués de la musique classique. C’est ce qui rend le concert différent, plus vivant… mais aussi plus risqué ! A chaque concert, je me mets en danger, émotionnellement et artistiquement. J’aime tenter une nuance inattendue, des tempi enlevés… je ne joue pas « tranquille ». Je pourrais me contenter de la ligne droite, de l’autoroute où aucune surprise ne m’attendrait, mais je préfère la nationale, le gros camion qui surgit tout à coup, le piéton qui traverse sans prévenir… ! Les gens sentent et aiment cet engagement. C’est une sorte de duel entre mon instrument, la musique et le public qui influe énormément mon jeu. La salle, en fonction de son silence et de son énergie, vous donne l’envie ou pas de vous donner à fond.
Vous définiriez-vous comme une outsider de la musique classique?
Beaucoup d’autres musiciens classiques s’investissent dans des actions en banlieue, en maison de retraite, ou en prison, plus qu’on ne le croit. Mais certainement pas les vedettes et les têtes d’affiche, beaucoup plus impliquées dans leur carrière internationale. L’acte gratuit vient de ceux qui ne sont pas à la recherche d’une visibilité médiatique, d’une notoriété personnelle, mais de ceux qui croient en l’art comme un vecteur d’union, à sa dimension salvatrice.
Je m’inscris dans une démarche communautaire, en me servant par exemple des réseaux sociaux pour financer mes disques. Les gens en ont assez de se voir imposer, à la radio ou à la télévision, des choses qui ne les intéressent pas : je leur propose donc de participer au financement d’une culture qui leur parle. J’encourage cet esprit « j’aide parce que j’y crois ». J’ai crée mon propre label, Air Note, pour cette même raison : échapper à un système fermé qui rejette ceux qui ne rentrent pas dans le moule et ne sont donc soi-disant pas vendables. Même dans le milieu de la musique classique, il vaut mieux être jolie, sympa, ouverte…
D’où votre refus de vous mettre en avant sur les pochettes de vos disques?
Oui, certainement. Je prends ma revanche face à toutes ces pochettes sirupeuses où les filles à demi nues s’étalent sur leur piano ! Je n’ai rien contre une photo, du moment qu’elle dénote une vraie personnalité, comme celles très typées de Stravinsky ou Glenn Gould. Pour les deux dernières c’est un graphiste au talent incroyable, Scott Pennor’s, qui a créé une identité visuelle originale. Sur un même disque j’aime l’idée de faire travailler plusieurs talents, je ne suis pas toute seule : sans graphiste, sans ingénieur du son, sans piano, sans compositeur, je n’existe pas. C’est une histoire à plusieurs.
Votre approche plus démocratique de la musique et de l’art en général est-elle une façon de pallier à un défaut de son enseignement, de sa transmission?
Beaucoup de professeurs sont malheureux parce qu’ils sont venus à l’enseignement par défaut, par impossibilité de poursuivre une carrière de soliste, et n’ont donc pas vraiment choisi de se trouver face à une classe, au collège comme au conservatoire. On ne les respecte même pas pour avoir fait ces études, souvent très longues, ils sont mal payés et on ne leur donne aucun moyen…
Par ailleurs, une tendance actuelle tend à n’évoquer la musique que sous l’angle du plaisir et du jeu, on veut faire croire qu’elle n’est qu’une distraction facile, mais ce n’est pas vrai. Elle implique travail, sacrifices, efforts, et je serais hypocrite en disant que cela vient tout seul. On ne devient pas Bach ou Delacroix pas hasard, il faut une recherche qui peut durer le temps d’une vie. C’est une passion bien sûr, mais aussi une rigueur que l’on poursuit aux dépens d’autre chose. Certains font une croix sur famille et enfants car leur art compte avant tout : c’est d’une grande noblesse, mais cela reste un sacrifice. Un mot qui devient presque tabou !
On veut faire croire qu’il suffit de passer dans une émission de télé pour réussir, mais c’est prendre les gens pour des imbéciles que de leur donner cette illusion. Être musicien est un travail quotidien qui confine à l’acharnement. Répéter encore et encore les mêmes deux mesures, le même geste technique, ce n’est pas humain ! La dureté de la tâche est ce qui la rend intéressante, passionnante. Certes, il y a un peu de masochisme là-dedans, mais cet effort fait partie de la construction de l’individu. Un monde sans aspérités n’a aucun intérêt, la vie et les autres n’ont rien de lisse. Les choses nous résistent, et l’artiste se nourrit de cette dureté, de cette violence. Il faudrait dépoussiérer et repenser l’enseignement de la musique, les méthodes pédagogiques. Mais pour faire bouger les choses, il faut être nombreux dans la même dynamique.
N’avez-vous pas l’impression parfois de vous battre contre des moulins?
Si, bien sûr. Je cumule le fait d’être une femme (parmi les pianistes reconnus, les hommes sont encore majoritaires), d’origine syrienne (ce dont je suis très fière, mais qu’on me renvoie sans cesse à la figure tout en s’étonnant qu’une « arabe » joue du piano), et qui en plus n’a pas sa langue dans sa poche ! Je ne rentre pas dans le cadre du piano classique très propre sur lui. Plus le temps passe et plus les portes se ferment. Le petit monde de la musique classique reste très conservateur, très replié sur lui-même, et ne cherche surtout pas à se remettre en question. Ce qui n’empêche pas de se battre!